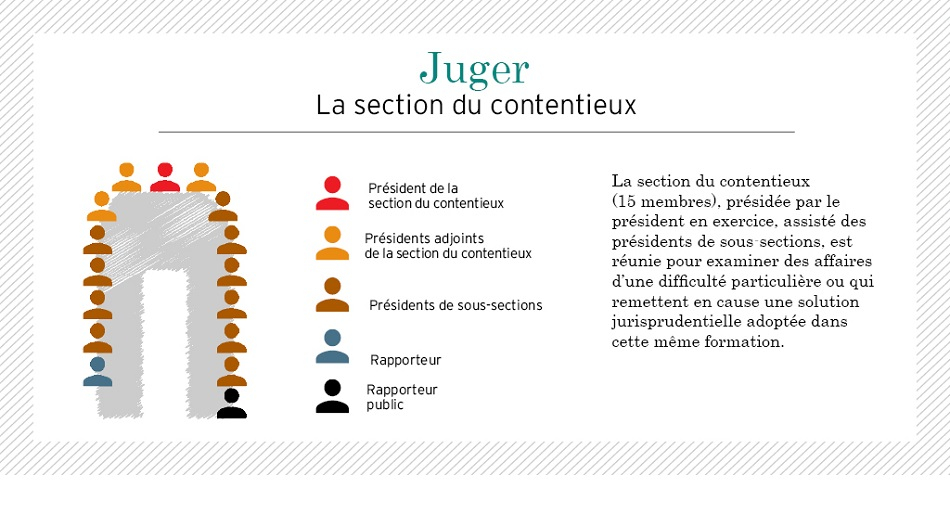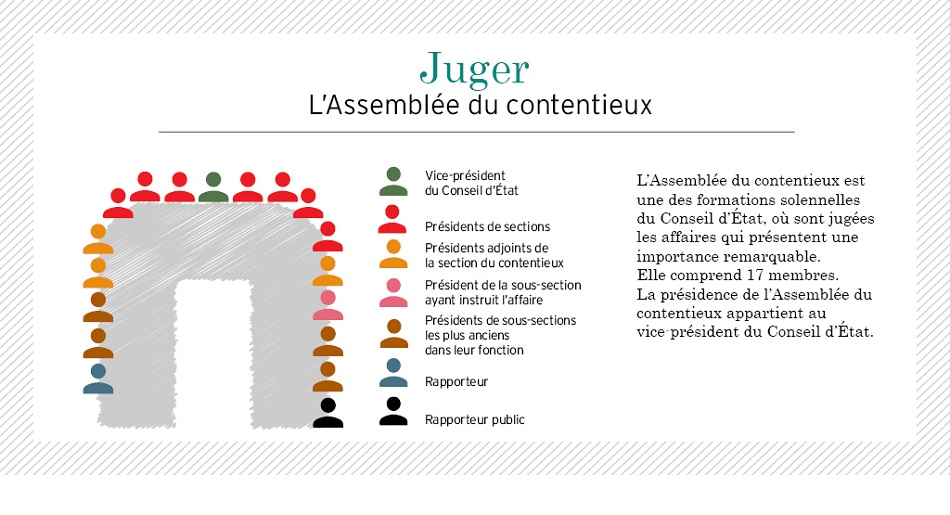Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de droit administratif (L2).
Pendant longtemps, ces sources internes ont quasi exclusivement été des sources jurisprudentielles. Elles se limitaient à la jurisprudence de principe du Conseil d’État, qui posait les règles du droit administratif.
Aujourd’hui, si la jurisprudence conserve un poids important, elle n’est plus la seule source interne du droit administratif. On constate 2 mouvements :
- Le Conseil d’État n’est plus la seule juridiction interne à rendre des décisions qui intéressent le droit administratif.
Le Conseil constitutionnel, créé par la Constitution de 1958 dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité, rend des décisions qui intéressent le fonctionnement de l’administration et qui influencent le droit administratif.
- Les textes prennent une place de plus en plus importante.
Articles de Constitution, lois, règlements : ces textes sont devenus des sources du droit administratif, parce qu’ils posent des règles intéressant le droit administratif.
Par exemple : le CRPA, depuis 2015.
Section 1 : Les sources constitutionnelles
Le droit administratif a toujours été influencé par l’existence d’une constitution, qui contient des règles qui intéressent le fonctionnement de l’administration.
Aujourd’hui, la situation est différente : il y a d’autres éléments qui ont une influence sur le droit administratif et qui incarnent la constitutionnalisation du droit administratif :
- La diversification des sources constitutionnelles : si l’administration doit respecter la Constitution, le mot “constitution” s’entend aujourd’hui au pluriel.
Le bloc de constitutionnalité constitue des normes qui doivent être respectées aussi bien par le législateur que par l’administration.
- La création de la question prioritaire de constitutionnalité en 2008 a fait apparaître le Conseil constitutionnel comme un acteur du procès devant le juge ordinaire comme administratif.
→ Il est devenu un acteur du droit administratif par le biais de la procédure de la QPC.
§ 1. Le respect de la Constitution par l’administration
A – Le principe
L’administration est soumise à un certain nombre de contraintes issues de la Constitution.
Conseil d’État, 1960, Société EKY :
Pour la première fois, le Conseil d’État annule un décret qui est contraire à une norme constitutionnelle.
Il ne fait donc aucun doute que le juge administratif est juge de la constitutionnalité des actes administratifs. Il peut annuler, à la suite d’un REP, un acte qui ne respecte pas une norme constitutionnelle.
B – L’exception : la théorie de la loi-écran
Lorsque la loi fait écran entre l’acte administratif et la norme constitutionnelle, alors le juge administratif s’estime incompétent, car il estime qu’il ne lui revient pas de faire du contrôle de constitutionnalité des lois.
Il suit un raisonnement syllogistique :
Par exemple, un acte administratif est édicté sur le fondement d’une loi, puis un moyen d’illégalité est soulevé parce que l’acte administratif ne respecterait pas la Constitution.
Si le juge opérait un contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif, cela reviendrait implicitement à faire un contrôle de constitutionnalité de la loi ayant servi de fondement juridique à l’acte administratif → il n’a pas le droit de le faire.
→ La loi fait écran entre l’acte administratif et la norme constitutionnelle.
Conseil d’État, 1936, Arrighi :
Dans cet arrêt de principe, le Conseil d’État invente et met en oeuvre la théorie de l’écran législatif, dans le but de ne pas être le juge de la loi.
Aujourd’hui, le principe demeure, mais 2 choses ont changé :
1- la création du Conseil constitutionnel ;
2- l’arrêt Nicolo.
Dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État supprime l’écran législatif en matière conventionnelle, parce que le Conseil constitutionnel a incité dans sa décision IVG les juridictions ordinaires à exercer un contrôle de conventionnalité.
💡 Il est très fréquent que les actes administratifs sont édictés sur la base d’une loi.
Exception à l’exception : l’écran législatif transparent.
Conseil d’État, 1991, Quintin :
Les lois d’habilitations, qui habilitent le gouvernement à agir par ordonnances sur le fondement de l’article 38, sont des lois très courtes et largement vides (souvent 2 articles).
Ces lois sont si courtes et vides que l’écran formé par ce texte est considéré comme “transparent” et n’empêche donc pas le contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif par le juge administratif.
§ 2. La diversification des sources constitutionnelles
A – Les articles de la Constitution de 1958 relatifs à l’administration
L’article 13 désigne les pouvoirs administratifs du Président de la République.
L’article 21 désigne les pouvoirs administratifs du Premier ministre.
Les articles 19 et 22 sont relatifs au contreseing des décrets (les conditions dans lesquelles les ministres doivent contresigner les décrets pris par le Président de la République ou le Premier ministre.
L’article 34 définit le domaine de la loi, et l’article 37 le domaine du règlement (= actes administratifs pouvant être édictés par le Premier ministre).
L’article 38 est relatif aux ordonnances.
Les articles 72 et suivants concernent les collectivités territoriales.
L’administration, quand elle agit, doit mettre en oeuvre et respecter les articles qui la concernent directement.
B – Les autres normes figurant dans le bloc de constitutionnalité
Enjeu : plus il y a de normes constitutionnelles, plus le contrôle est intense, important et diversifié – pour le Conseil constitutionnel, mais aussi pour le juge administratif qui opère un contrôle de constitutionnalité des actes administratifs.
On doit l’expression “bloc de constitutionnalité” à la doctrine.
C’est le professeur Louis Favoreu qui affirme d’abord que les normes constitutionnelles sont plus diverses que le seul texte de 1958, quand il constate que la Constitution de 1958 fait des renvois, notamment au préambule de la Constitution de 1946.
Conseil constitutionnel, 1971, Liberté d’association :
Reconnaît pour la 1ère fois de son histoire un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : celui de la liberté d’association.
Affirme que le préambule de la Constitution de 1946 a valeur constitutionnelle. Ce préambule fait référence à la DDHC, mais aussi aux PFRLR → les PFRLR ont donc valeur constitutionnelle.
La DDHC de 1789 proclame des droits et libertés (qui acquièrent aussi valeur constitutionnelle), alors que le préambule de 1946 se contente d’affirmer l’attachement aux PFRLR sans les énumérer.
Le Conseil constitutionnel décide donc de remplir cette catégorie en affirmant pour la 1ère fois qu’une liberté constitue un PFRLR au sens du préambule de la Constitution de 1946.
Cette décision est remarquable, car elle contribue à étendre les éléments ayant valeur constitutionnelle.
Aujourd’hui, une dizaine de PFRLR ont été dégagés par des décisions du Conseil constitutionnel.
§ 3. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La QPC résulte de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a inséré l’article 61-1 de la Constitution, complété ensuite par la loi organique du 10 décembre 2009.
Les autorités de saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC sont exclusivement le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Un citoyen ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC.
Avec la procédure de la QPC, le Conseil constitutionnel conserve le monopole en matière de contrôle de constitutionnalité des lois.
La QPC n’a pas aboli la théorie de la loi-écran : quand une loi fait écran entre un acte administratif et une norme constitutionnelle, le juge administratif ne peut toujours pas contrôler la constitutionnalité de cet acte.
Cependant, la QPC peut constituer une solution de contournement : le requérant confronté à une hypothèse d’écran à l’occasion d’un procès devant le juge administratif peut déposer une QPC.
⚠️ En France, jamais les juridictions ordinaires ne pratiquent le contrôle de constitutionnalité des lois.
A – Le rôle du juge administratif dans la QPC
Il faut commencer par rappeler que la QPC ne peut pas être soulevée à l’occasion d’une instance en cours.
Il n’y a pas de QPC sans procès.
À l’occasion d’une instance en cours, un requérant peut déposer, par le biais d’un mémoire distinct, une QPC qui conteste une disposition législative qui serait contraire à un droit ou à une liberté que la Constitution garantit.
1) Le rôle des juridictions ordinaires
L’article 61-1 de la Constitution dit qu’une QPC peut être soulevée à l’occasion d’une “instance en cours”.
Cela est entendu le plus largement possible : il est possible de soulever une QPC en 1ère instance, en appel, en cassation… devant le juge administratif classique comme devant le juge administratif des référés.
Une fois le juge administratif ordinaire saisi, il doit être le 1er filtre, c’est-à-dire celui qui examine en 1er si la disposition législative visée par la QPC est digne d’être transmise au Conseil d’État.
Pour ne pas engorger le Conseil constitutionnel de QPC inutiles, le juge ordinaire doit :
- Vérifier que la disposition législative visée par la QPC est applicable au litige.
Le pouvoir constituant a voulu, en créant la QPC, qu’il y ait un lien entre la disposition et le litige ; s’il n’y en a pas, alors la QPC n’est pas transmise.
- Vérifier que la disposition législative contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Exception : la loi organique de 2009 précise qu’on peut y déroger “en cas de changement de circonstances de droit ou de fait”.
- La question ne doit pas “être dépourvue de caractère sérieux”.
Est-ce que la question présente un intérêt du point de vue juridique ?
Si ces 3 conditions sont remplies, le juge administratif saisi transmet la QPC au Conseil d’État.
Aujourd’hui, ~20% des QPC posées devant les juridictions ordinaires passent ce 1er filtre.
2) Le rôle du Conseil d’État
Le Conseil d’État joue un rôle de second filtre.
Il opère un certain nombre de vérifications pour vérifier si la QPC ne mérite pas d’être transmise au Conseil constitutionnel.
a) La notion de disposition législative
L’article 61-1 dispose que seule une disposition législative peut faire l’objet d’une QPC.
Le Conseil d’État commence par vérifier que la QPC vise une disposition législative au sens de l’article 61-1.
“Disposition législative” peut désigner un extrait :
1- d’une loi ordinaire ;
2- d’une loi organique ;
3- d’une ordonnance ratifiée par le Parlement ;
4- d’une “loi de pays” = acte voté par l’assemblée de Nouvelle-Calédonie.
💡 La QPC ne permet pas un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. Elle permet seulement de vérifier si une disposition législative contrevient à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
→ La disposition constitutionnelle invoquée doit donner un droit ou octroyer une liberté à des personnes.
b) Les droits et libertés garantis par la Constitution
Après avoir vérifié les conditions relatives à la QPC elle-même, le Conseil d’État doit vérifier les conditions relatives à sa transmission → second filtre.
La loi organique de 2009 a posé 3 conditions semblables à celles du 1er filtre :
- La disposition législative doit être applicable au litige ;
- La disposition législative doit ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- La question doit être nouvelle et présenter un caractère sérieux.
Une disposition est “nouvelle” lorsqu’elle n’a fait l’objet d’aucune application dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ou que sa nouveauté pourrait résulter de l’intérêt que revêt son examen.
Cette condition est remplie dès lors que le Conseil d’État estime que la question posée présente un intérêt du point de vue de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Cet intérêt pour aussi être un intérêt de principe ou un intérêt quantitatif (lorsque la question est susceptible de se poser à de nombreuses reprises dans de nombreux procès en cours).
Le Conseil d’État examine donc la question posée au regard de la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel.
Soit il trouve la réponse de manière évidente, soit il ne la trouve pas et constate donc un intérêt à transmettre la question.
Cette étape ressemble à un pré-contrôle de constitutionnalité, mais qui n’est fait pour que pour savoir si la 3ème condition posée par la loi organique de 2009 est remplie.
Le taux de transmission est ici encore de ~20%.
Objectif du Conseil d’État : ne transmettre au Conseil constitutionnel que les plus belles QPC.
Dans les hypothèses où le Conseil d’État est saisi en premier et dernier ressort, il n’y a qu’un seul filtre.
B – Le rôle du Conseil constitutionnel
1) L’examen de la disposition législative
Le Conseil constitutionnel doit procéder à un contrôle de constitutionnalité de la disposition législative.
Ce contrôle est spécifique : il se fait a posteriori et ne porte que sur le respect par la disposition législative du droit ou de la liberté constitutionnelle invoquée dans la QPC.
Ça n’est donc en réalité pas un contrôle de constitutionnalité d’ordre général, mais un contrôle de conformité de la disposition législative par rapport au droit ou à la liberté qui est :
> constitutionnelle ;
> invoquée par le requérant dans la QPC.
L’examen par le Conseil constitutionnel consiste à se demander si la disposition respecte le droit ou la liberté constitutionnelle en question.
2 hypothèses sont envisageables :
- Le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative est conforme au droit ou à la liberté constitutionnelle invoquée.
Cela a 2 conséquences :
- La disposition législative conserve sa place dans l’ordre juridique français.
- La disposition législative déclarée conforme sera appliquée par le juge ordinaire pour résoudre le litige dont il a été saisi.
- Le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative est contraire au droit ou à la liberté constitutionnelle invoquée.
Cela a 2 conséquences :
- La disposition législative est abrogée = elle disparaît de l’ordonnancement juridique pour l’avenir.
- Le juge ordinaire ne peut plus appliquer cette disposition législative au litige.
Le Conseil constitutionnel a estimé que, dans certaines hypothèses, la disparition de la disposition législative pouvait être problématique au regard du nombre de procédures en cours qui pourraient être concernées.
Il s’en est notamment rendu compte au sujet du régime de la garde à vue.
Conseil d’État, 2004, Association AC! :
Met en place une modulation dans le temps de l’annulation contentieuse, permettant au juge administratif de reporter la date de l’annulation de l’acte administratif dont il vient de prononcer l’illégalité.
Objectif : laisser à l’administration le temps de se préparer à cette annulation.
Conseil constitutionnel, 2010, Mlle Danielle S. :
Concernait les hospitalisations d’office, prévues dans le Code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel affirme pour la 1ère fois qu’il lui est possible de reporter dans le temps les effets de l’abrogation.
Entre-temps, c’est l’ancienne disposition qui s’applique au litige en cours.
→ Progrès vis-à-vis de l’État de droit.
Le Conseil d’État est devenu un acteur du contentieux administratif, parce que les décisions qu’il rend dans le cadre des QPC ont des effets dans les procès en cours.
La QPC a largement participé au mouvement de constitutionnalisation du droit administratif.
Section 2 : Les sources législatives et règlementaires
Les sources législatives et règlementaires sont les sources qui se placent, dans la hiérarchie des normes, juste en dessous des normes constitutionnelles.
Ce sont des normes de droit écrit, qui ont pris une place de plus en plus importante parmi les sources du droit administratif.
Exemple : avec le CRPA de 2015, les sources législatives et règlementaires acquièrent une importance considérable.
§ 1. Les sources législatives
À la naissance du droit administratif, le législateur ne s’est pas intéressé au droit administratif.
C’est la jurisprudence qui a pris le relais, avec des arrêts de principe du Conseil d’État qui ont fixé les règles du droit administratif.
Aujourd’hui, il arrive fréquemment que le législateur, dans des textes relatifs à l’administration et aux procédures devant le juge administratif, fasse du droit administratif.
Quand la place du législateur augmente, la place de la jurisprudence diminue.
A – Les différents types d’actes législatifs
Du point de vue du droit administratif, ce qu’on appelle les actes législatifs (= les actes qui ont une valeur législative dans la hiérarchie des normes) sont susceptibles d’être de différents types :
1) Les lois
Ce terme, en apparence simple, est en réalité plus complexe qu’il n’y paraît. Il existe différentes catégories de lois dont l’objet et la valeur juridique varient :
- La loi constitutionnelle a pour objet de modifier la Constitution.
Elle nécessite une majorité des 3/5 des parlementaires présents.
Elle a la valeur de la Constitution.
- La loi organique a pour objet de compléter le texte de la Constitution de 1958.
Elle fixe des principes complémentaires pour mieux comprendre l’objet et la portée d’une disposition de la Constitution.
Elle présente 2 spécificités :
- Procédurale : elle est obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel avant son entrée en vigueur.
- Valeur : dans la hiérarchie des normes, elle se trouve au-dessus des lois ordinaires et en dessous des lois constitutionnelles.
- La loi ordinaire est celle adoptée le plus fréquemment par le Parlement.
Elle entre dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34.
- La loi adoptée par référendum est prévue à l’article 11 de la Constitution.
Elle n’est pas adoptée au terme de la procédure parlementaire, mais en faisant intervenir le peuple. Elle ne peut pas être soumise au Conseil constitutionnel, car elles sont l’expression directe de la volonté générale du peuple.
Elles ont la même valeur que les lois ordinaires.
2) Les autres actes législatifs
Ces autres actes législatifs ont la même valeur qu’une loi ordinaire.
Hypothèse de l’article 16 de la Constitution :
Les pouvoirs d’exception, qui n’ont été mis en oeuvre qu’une seule fois, à l’occasion de la guerre d’Algérie.
La question de la valeur juridique des actes passés dans ce cadre s’est posée. On distingue 2 interprétations :
- Celui qui les édictait était une autorité administrative : ce sont donc des actes administratifs, susceptibles de faire l’objet d’un REP devant le juge administratif.
- Ce ne sont pas des actes administratifs, car l’objet de l’article 16 de la Constitution est de transférer des pouvoirs du Parlement vers le Président, et notamment d’édicter des décrets dans le domaine de la loi.
Ils sont donc insusceptibles de recours devant le juge administratif.
Conseil d’État, 1962, Rubin de Servens :
Les actes pris par le Président de la République conformément à l’article 16 sont des actes législatifs, qui ne peuvent pas faire l’objet de REP.
Le Conseil d’État retient que l’article 16 organise le transfert de pouvoirs législatifs vers le Président de la République → les actes appartiennent au domaine de la loi.
Hypothèse de l’article 38 de la Constitution : ordonnances.
Permet au parlement d’habiliter le gouvernement à agir dans le domaine de la loi pendant une durée déterminée.
Idée : parfois, il faut agir vite, mais adopter une loi prend du temps.
Le Parlement adopte une loi d’habilitation, qui habilite le gouvernement à agir dans le domaine de la loi pour une durée déterminée.
Le gouvernement peut ensuite adopter des ordonnances = des actes administratifs qui interviennent dans le domaine de la loi.
Au terme du délai, le Parlement ratifie les ordonnances, ce qui leur donne valeur législative.
La valeur juridique d’une ordonnance varie selon les étapes.
Tant qu’elle n’a pas été ratifiée par le Parlement, l’ordonnance est un acte administratif, qui peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Conseil d’État, 1961, Fédération nationale des syndicats de police :
Tant qu’une ordonnance n’a pas été ratifiée, elle est un acte administratif → peut être contestée devant le juge administratif.
Une fois que l’ordonnance a fait l’objet d’une loi de ratification édictée par le Parlement, elle acquiert valeur législative.
Elle ne peut alors plus faire l’objet d’un REP devant le juge administratif, mais seulement l’objet d’une QPC.
Certaines ordonnances peuvent mettre du temps à être ratifiées. Quel est le statut de l’ordonnance non ratifiée malgré l’expiration du délai ?
Conseil constitutionnel, 2020, Association Force 5 :
Les ordonnances non ratifiées qui ont passé le délai d’habilitation sont “des actes législatifs au sens de l’article 61-1 de la Constitution”.
Ce sont donc des actes susceptibles de faire l’objet d’une QPC.
Le Conseil d’État a répliqué :
Conseil d’État, 2020, Fédération CFDT des Finances et autres :
Les ordonnances non ratifiées peuvent faire l’objet d’une QPC, mais ces mêmes actes peuvent également être considérés comme des actes administratifs pouvant faire l’objet d’un REP si l’on souhaite contester autre chose que la constitutionnalité de l’acte.
Le Conseil d’État a considéré que, s’il veut vraiment protéger les requérants, il doit continuer de permettre de considérer que cet acte administratif est aussi susceptible de REP.
Il a donc considéré que ces ordonnances non ratifiées ayant passé leurs délais d’habilitation sont des actes administratifs susceptibles de REP.
Cliquer ici pour voir le communiqué de presse sur le sujet (.pdf).
B – Le domaine des actes législatifs
Avant 1958, le domaine de la loi était illimité. Des actes règlementaires pouvaient être édictés par le gouvernement, mais ces actes étaient exclusivement des actes d’application des lois.
→ Pas de pouvoir règlementaire autonome avant 1958.
Conseil d’État, 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est :
Censure un règlement édicté par le gouvernement, dès lors qu’il n’a pas été pris sur le fondement du pouvoir législatif.
À cette époque, il n’existe pas de pouvoir règlementaire autonome : le gouvernement ne peut édicter que des actes d’application des lois.
La Constitution de 1958, qui s’inscrit dans une démarche de rationalisation du parlementarisme, a tout changé.
Idée : la loi doit désormais être limitée ; elle ne peut plus intervenir dans n’importe quel domaine.
On donne un domaine règlementé à la loi, avec 2 articles jumeaux :
> l’article 34 de la Constitution liste les domaines dans lesquels la loi peut intervenir ;
> l’article 37 dispose que “les matières autres que celles mentionnées à l’article 34 relèvent du pouvoir règlementaire du gouvernement”.
Le Conseil constitutionnel est chargé de faire respecter le domaine de la loi.
Il peut censurer une loi ou un article de loi qui ne relève pas du domaine législatif, mais du domaine règlementaire.
Le Conseil d’État est chargé de faire respecter le domaine règlementaire.
Il peut censurer un règlement ou un article d’un règlement qui a posé des règles dans un domaine qui relève de la loi.
Exemple : Conseil d’État, 2002, M. Ulmann :
Devait statuer sur la légalité d’un décret portant sur le droit d’accès aux documents administratifs.
Décide que certaines dispositions de ce décret relèvent du domaine de la loi, sont donc illégales et les annule.
C – L’applicabilité des actes législatifs
Il y a des conditions que les lois doivent remplir pour être considérées comme applicables en droit français et pouvoir donc être invoquées à l’appui d’un recours.
La loi doit avoir été publiée (au Journal officiel). Si une loi n’est pas publiée, elle ne produit pas d’effets juridiques → elle est inapplicable en droit français.
Conseil d’État, 1957, Barrot :
Affirme qu’une loi non publiée au JO est inapplicable : elle ne produit pas d’effets juridiques et elle ne peut pas servir de base légale aux actes administratifs pris sur son fondement.
La loi doit contenir des mesures suffisamment précises.
Le législateur, lorsqu’il édicte une loi, a 2 possibilités :
> soit il édicte une loi suffisamment complète et précise pour s’appliquer directement ;
> soit il édicte une loi qui fixe de grands principes, qui sera précisée par des décrets d’application.
Les dispositions de la loi doivent présenter un caractère normatif : la loi doit interdire, prescrire, autoriser, poser des règles…
Idée : elle doit imposer la volonté du peuple, donc être normative.
Si la loi est détournée de son objet pour des affirmations purement politiques ou philosophiques, alors on considère que les dispositions ne sont pas normatives et sont à ce titre considérées inapplicables en droit français et ne sont donc pas susceptibles d’être invocables devant le juge.
Le Sénat peut adopter une résolution, qui est un acte par lequel il ne prescrit rien, mais peut prendre position sur un sujet de société.
Conseil d’État, 1995, Préfet de la Guadeloupe :
Un requérant invoque des dispositions législatives à l’appui d’un REP contre un décret.
Le Conseil d’État, ayant lui-même à appliquer ces dispositions législatives, estime que leur sens n’est pas clair et les considère donc inapplicables.
Il y a donc une 3e condition : les dispositions législatives doivent être suffisamment précises pour que leur portée et leur sens soit évident.
💡 Rappelle la théorie de l’acte clair en droit de l’UE.
Conseil d’État, 1999, M. Rouquette :
Considère que des dispositions législatives ne sont pas normatives dès lors qu’elles ne contiennent pas de prescriptions, mais une simple affirmation de principe.
→ Ces dispositions ne sauraient être invoquées à l’appui d’un recours devant le juge administratif.
§ 2. Les sources règlementaires
A – Les titulaires du pouvoir règlementaire
1) Le pouvoir règlementaire général
Le pouvoir règlementaire général est désigné comme tel dans la mesure où les actes qu’il édicte peuvent intervenir dans tous les domaines relevant de l’article 37 de la Constitution.
+ ce sont des actes qui ont une portée nationale.
Le Premier ministre est considéré par la Constitution de 1958 comme l’autorité de principe en matière règlementaire.
Il est désigné par la Constitution comme le titulaire du pouvoir règlementaire (= celui qui peut édicter des règlements administratifs).
Il peut édicter 3 types de règlements administratifs :
- Les règlements d’application des lois ;
- Les décrets autonomes ;
Ils interviennent dans les domaines de l’article 37 de la Constitution et n’ont aucun lien avec la loi (ils sont “autonomes” du législateur).
- Les règlements de police.
C’est la jurisprudence (et non la Constitution) qui lui donne ce pouvoir :
Conseil d’État, 1919, Labonne :
Estime que le gouvernement dispose, en dehors de toute habilitation constitutionnelle ou législative, de pouvoirs propres pour édicter des mesures de police applicables sur l’ensemble du territoire national.
Pour faire face à des troubles importants à l’ordre public, le Premier ministre peut prendre un décret en matière de police applicable sur l’ensemble du territoire national.
La toute première mesure Covid a été un décret type Labonne : le Premier ministre a édicté, sur le fondement de ce pouvoir jurisprudentiel, un décret par lequel il a restreint les libertés sur le territoire national.
Ce 3ème pouvoir est rarement utilisé.
Le Premier ministre est donc l’autorité de principe à qui on a confié le pouvoir règlementaire général.
b) Le Président de la République
Le Président de la République joue en apparence un rôle secondaire en matière de pouvoir règlementaire.
D’après l’article 13 de la Constitution, il est compétent pour signer les décrets et les ordonnances délibérées en Conseil des ministres.
Si on regarde la Constitution de 1958, on constate que les conditions dans lesquelles ces décrets et ces ordonnances doivent être délibérées en Conseil des ministres ne sont pas précisées.
Le Conseil d’État a répondu que, dès lors que les dispositions constitutionnelles sont muettes, c’est au Président de la République de décider :
Conseil d’État, 1992, M. Meyet :
Affirme 2 choses :
- À défaut de disposition constitutionnelle, c’est au Président de la République de choisir si un décret ou une ordonnance doit être délibérée en Conseil des ministres.
Cela signifie que la lecture qu’on peut avoir sur la Constitution de 1958 s’en trouve changée : quand il le veut, le Président de la République peut faire délibérer en Conseil des ministres des décrets et ordonnances.
→ Il est lui-même maître du domaine dans lequel il peut prendre des actes règlementaires.
→ La compétence de principe du Premier ministre est contestée.
- Tous les décrets et toutes les ordonnances délibérées en Conseil des ministres ont pour auteur de le Président de la République.
Celui-ci en endorse la responsabilité politique et juridique.
2) Les pouvoirs règlementaires spécialisés
Les pouvoirs règlementaires spécialisés renvoient à :
- toutes les hypothèses d’exercice du pouvoir règlementaire qui ne peuvent intervenir que dans un domaine propre ;
- ou à toutes les hypothèses du pouvoir règlementaire sur une portion du territoire national.
Ils peuvent être attribués :
> par un texte ;
> par la jurisprudence.
a) La spécialisation selon un texte
Un texte – généralement législatif – peut confier à une autorité administrative un pouvoir règlementaire spécialisé.
Plusieurs conditions sont posées :
Conseil constitutionnel, 1989, Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Dit 2 choses importantes :
- La Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité autre que le Premier ministre et le Président de la République un pouvoir règlementaire ;
- Ce pouvoir règlementaire “ne concerne que des mesures à portée limitée, tant par leur champ d’application que par leur contenu”.
Dans cette décision CSA, le législateur avait donné un pouvoir règlementaire pas assez spécialisé par rapport au pouvoir règlementaire générale.
Conséquence : le législateur, en respectant cette double condition posée par le Conseil constitutionnel, peut donner un pouvoir règlementaire spécialisé à toutes les autorités administratives dont il estime qu’elles ont besoin de fixer des règles générales de type règlementaire.
b) La spécialisation selon la jurisprudence
Adage en droit administratif : “il n’y a pas de pouvoir règlementaire sans texte”.
Selon cet adage, le pouvoir règlementaire ne peut pas être dévolu à une autorité en l’absence de texte.
Cet adage, s’il permet de mettre l’accent sur le fondement textuel du pouvoir règlementaire, connaît des exceptions : il existe des hypothèses de pouvoir règlementaire sans texte.
2 hypothèses :
1- le pouvoir de police administrative du Premier ministre ;
2- le pouvoir règlementaire du chef de service.
L’arrêt Labonne du Conseil d’État de 1919 affirme que, par exception, le Premier ministre dispose d’un pouvoir règlementaire spécialisé en matière de police qui lui permet d’édicter des mesures de police applicables sur l’ensemble du territoire dans le cas où il faut faire face à un trouble à l’ordre public national (ex : un virus).
Singularité de ce pouvoir : son fondement.
Pour agir dans ce domaine, le Premier ministre peut user de “ses pouvoirs propres”, sans qu’un texte ne lui ait octroyé ce pouvoir.
→ Le pouvoir règlementaire en matière de police du Premier ministre possède un fondement jurisprudentiel.
Précision : cette décision a été rendue avant la Constitution de 1958, à l’époque où il n’existait pas de Premier ministre.
Cet arrêt Labonne a été actualisé :
Conseil d’État, 1960, SARL Restaurant Nicolas :
Adapte l’arrêt Labonne à la Constitution de 1958 : fait du Premier ministre celui qui est titulaire d’un pouvoir règlementaire en matière de police sur le fondement jurisprudentiel de l’arrêt Labonne.
Le pouvoir règlementaire du chef de service a lui été posé par une grande décision :
Conseil d’État, 1936, Jamart :
Tout chef de service peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, même si aucune disposition textuelle n’a confié à l’autorité concernée un pouvoir règlementaire.
Ici, un chef de service est toute personne qui a autorité sur des agents, qui exerce un pouvoir hiérarchique (qui peut donner des ordres, des instructions, et modifier leurs décisions).
La tradition Jamart concerne un ministre ; or les ministres ne sont pas titulaires d’un pouvoir règlementaire : on considérait qu’ils devaient agir sur habilitation de la loi ou par délégation du Premier ministre.
Les ministres se trouvaient donc dans une situation étrange, où ils ne pouvaient pas agir par eux-mêmes.
Pour combler cette lacune, la décision Jamart dit que les ministres sont chefs de service et disposent donc d’un pouvoir règlementaire spécialisé.
B – Les caractéristiques du pouvoir règlementaire
Le pouvoir règlementaire est celui qui donne à une autorité administrative la compétence pour édicter des mesures générales et impersonnelles.
Il présente 2 caractéristiques essentielles :
1) L’impossibilité d’exercer le pouvoir règlementaire “au-delà du texte”
“Pas de pouvoir règlementaire sans texte, pas de pouvoir règlementaire au-delà du texte”.
Le texte est à la fois le fondement juridique du pouvoir règlementaire et sa limite.
C’est logique, puisqu’on a vu que l’habilitation par le pouvoir législatif doit être strictement délimitée sur les plans matériel et territorial.
L’autorité qui en est le titulaire ne saurait dépasser ce qui lui est autorisé → ne saurait aller au-delà du texte.
Si une autorité administrative édicte un acte règlementaire dans un domaine qui dépasse l’habilitation législative ou jurisprudentielle dont elle bénéficie, elle est incompétente pour édicter cet acte → si un recours est formé, le juge pourra l’annuler pour incompétence.
2) L’obligation d’exercer le pouvoir règlementaire
L’étude du pouvoir règlementaire offre 3 hypothèses où l’autorité administrative investie d’un pouvoir se trouve obligée de l’utiliser :
a) L’obligation de prendre les règlements d’application des lois
Le Premier ministre est notamment chargé de prendre les décrets d’application des lois.
Ces décrets ont pour objet de préciser la portée des dispositions législatives.
Si le gouvernement ne prend pas ces décrets, la loi est inapplicable ; ça n’est donc pas une faculté, mais une obligation.
Conseil d’État, 1962, Kevers-Pascalis :
Annule pour la 1ère fois un refus du Premier ministre d’édicter les règlements nécessaires à l’application d’une loi.
Motif : “le Premier ministre n’a pas la faculté de prendre les décrets d’application d’une loi, il en a l’obligation”.
Mais que se passe-t-il s’il tarde ?
Conseil d’État, 2011, Société Cryo-Save-France :
De manière audacieuse, affirme pour la 1ère fois qu’il doit le faire dans un délai raisonnable, sans préciser ce qu’est un délai raisonnable.
Avantage de cette décision : met la pression sur le gouvernement, en instant qu’il doit veiller à ce que les décrets d’application soient pris dans un délai raisonnable.
Inconvénient : n’adopte pas un délai strict.
C’est le juge administratif qui apprécie au cas par cas le délai raisonnable.
En l’espèce, un délai de 2 ans et demi n’a pas été considéré comme déraisonnable.
b) L’obligation d’agir en matière de police administrative
Idée : quand on est une autorité administrative titulaire d’un pouvoir de police, on a l’obligation de faire usage de ce pouvoir pour faire face aux évènements susceptibles de troubler l’ordre public.
Si on ne le fait pas, on commet une abstention fautive, qui est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Conseil d’État, 1959, M. Doublet :
Il existait au bord d’une rivière un camping municipal. La rivière menaçait d’être en crue et d’envahir les bords de celle-ci, et notamment le terrain sur lequel était installé le camping.
Il y a eu une crue pendant la nuit, qui a fait des morts.
Le maire aurait dû prendre une mesure de police pour évacuer le camping.
c) L’obligation d’abroger des règlements illégaux
Cela fait penser à la décision Alitalia, qui souligne l’obligation d’abroger un acte administratif contraire aux objectifs d’une directive européenne non transposée dans les délais.
Conseil d’État, 1930, Despujol :
Toute autorité administrative règlementaire doit abroger un acte devenu illégal à la suite d’un changement de circonstances de droit.
La décision Alitalia est venue compléter Despujol dans le cas particulier des directives non transposées dans les délais.
C – La hiérarchie des actes règlementaires
On distingue une double hiérarchie au sein des actes règlementaires :
- Les pouvoirs règlementaires spécialisés sont soumis au pouvoir règlementaire d’ordre général.
Au sommet de la hiérarchie : actes règlementaires du Premier ministre et du Président de la République.
- Au sein même du pouvoir règlementaire d’ordre général, il y a une hiérarchie entre les décrets :
Décrets délibérés en Conseil des ministres > décrets pris après l’avis du Conseil d’État > décrets simples (= édictés sans l’avis d’aucune autre autorité).
Les décrets simples ne sauraient donc modifier les décrets délibérés en Conseil des ministres ou les décrets pris après l’avis du Conseil d’État.
Section 3 : Les sources jurisprudentielles : les principes généraux du droit
Si on s’arrête sur les sources jurisprudentielles, c’est parce que :
> le droit administratif est un droit principalement jurisprudentiel ;
> il est important de situer les règles jurisprudentielles dans la hiérarchie des normes en droit interne.
Les principes généraux du droit incarnent le pouvoir jurisprudentiel du Conseil d’État.
Idée : la juridiction suprême de l’ordre administratif peut, à l’occasion de litiges dont elle est saisie, poser des principes qui valent pour l’instance en cours, et surtout pour le futur de manière générale, et qui auront vocation à être opposables à l’administration.
§ 1. La notion de PGD
A – L’apparition de la notion
Il y a une ambiguïté, puisque la notion de PGD a été employée à 2 époques distinctes.
À la fin du 19ème siècle :
Tribunal des conflits, 8 février 1873, Dugave et Bransiet :
(Même jour que l’arrêt Blanco !)
Le Tribunal des conflits évoque “les principes généraux du droit avec lesquels les textes relatifs à l’administration doivent être conciliés”.
→ Les règles applicables à l’administration sont pour certaines textuelles et pour d’autres jurisprudentielles.
Par la suite, le Tribunal des conflits et le Conseil d’État ne vont pas faire en sorte d’expliciter quels sont ces principes. Même si le Tribunal des conflits a évoqué cette expression dès 1873, elle ne devient pas une notion juridique clairement identifiée.
À l’après-guerre :
Juste après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil d’État retrouve l’intérêt de pouvoir disposer d’une telle catégorie.
Conseil d’État, 1945, Aramu :
Décision de principe qui affirme l’existence de principes généraux du droit s’appliquant à l’administration.
Le Conseil d’État constate que, durant la Seconde Guerre mondiale, l’administration a pu mal faire ou appliquer strictement des textes, même barbares.
Il décide donc qu’au-delà des textes, il faut des principes généraux protégeant les administrés et les agents.
B – La définition de la notion
Seul le Conseil d’État peut dégager un principe général du droit ; les TA et CAA n’ont pas ce pouvoir, parce qu’ils rendent des décisions qui ne sont pas définitives.
On peut définir les principes généraux du droit comme des principes découverts par le Conseil d’État et qui doivent être respectés par l’administration sous peine d’illégalité.
Ils ont 2 caractéristiques principales :
- Ce sont des principes applicables même sans texte.
Ils s’imposent à l’administration par la force de la jurisprudence de principe.
Décision Aramu (1945) : les PGD sont applicables même en l’absence de texte.
- Ils s’imposent à toutes les autorités administratives, y compris le Président de la République et le Premier ministre.
Toute autorité administrative, lorsqu’elle agit, doit agir en respectant les principes généraux du droit.
Arrêt de principe :
Conseil d’État, 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseil :
Les PGD s’imposent à toute autorité administrative règlementaire (et en l’espèce, au Premier ministre).
§ 2. L’usage des PGD
A – Considérations générales sur l’usage des PGD par le juge
Les principes généraux du droit ont été inventés à la suite de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les juges ont constaté que les textes pouvaient mal faire, et qu’il convenait que la jurisprudence protège mieux ceux qui peuvent être victimes de l’administration.
Les PGD servent donc à protéger :
> les usagers du service public (”le public”), en invoquant des PGD protecteurs contre l’arbitraire administratif ;
> les agents publics, qui peuvent être victimes de leurs supérieurs hiérarchiques.
B – Illustrations
1) Conseil d’État, 1973, Dame Peynet :
Mme Peynet est infirmière dans un établissement public de santé ; elle annonce sa grossesse à son chef de service, qui la licencie le lendemain. Elle fait un REP contre cette décision de licenciement.
Le Conseil d’État constate que les textes de l’époque ne contiennent aucune disposition interdisant le licenciement d’une femme enceinte dans le secteur public, mais que le Code du travail interdisant le licenciement des salariés pour ce motif.
Pour combler cette lacune, il crée un PGD : l’interdiction de licencier une femme enceinte dans le secteur public.
En faisant cela, il protège la requérante et annule pour illégalité son licenciement.
Plutôt que de dire qu’il s’est inspiré du Code du travail, il dit que le Code du travail s’est inspiré du principe qu’il a créé (= le principe jurisprudentiel selon lequel il est interdit de licencier une femme enceinte).
Ici, le PGD est utilisé dans le but d’assurer la protection des agents publics.
Le Conseil d’État a aussi par exemple consacré :
> l’interdiction de rémunérer un agent public en dessous du SMIC ;
> l’obligation de proposer un autre emploi à un agent public définitivement atteint d’une inaptitude physique…
→ Les PGD ont servi à combler les lacunes textuelles du droit du service public.
2) Conseil d’État, 2002, M. Magiera :
Un homme fait un recours devant le TA de Versailles dans une affaire relevant du droit fiscal. Le TA statue 7 ans plus tard.
M. Magiera engage la responsabilité de l’État pour durée excessive d’un procès administratif (il fait un recours devant la juridiction administrative pour dénoncer la longueur excessive de la juridiction administrative !).
Le Conseil d’État relève la durée de l’examen de l’affaire devant le TA de 7 ans et 6 mois, alors que cette affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Il en déduit que la durée est excessive.
Il regarde les textes applicables à l’époque, notamment le CJA, et n’y trouve aucune disposition textuelle qui viendrait affirmer la nécessité de statuer dans des délais raisonnables.
Il crée donc un PGD : le droit pour les justiciables à être jugé dans un délai raisonnable.
§ 3. La place des PGD
A – La place des PGD dans la hiérarchie des normes
La question de la place des PGD dans la hiérarchie des normes a été à l’origine de nombreux débats doctrinaux.
On distingue 3 thèses :
- Les PGD ont la valeur du texte dont ils sont issus ou dont ils s’inspirent.
Si le juge trouve son inspiration dans une loi (ex : le Code du travail), alors le PGD a valeur législative.
Si le juge trouve son inspiration dans un traité international, alors le PGD a valeur conventionnelle.
Problème avec cette thèse : que faire des PGD qui n’ont aucune inspiration (= qui résultent de l’imaginaire du juge) ?
- Les PGD n’ont pas la même valeur selon ceux qui les ont dégagés.
Idée : quand un PGD est consacré par le Conseil constitutionnel en tant que principe à valeur constitutionnelle (PVC), alors il a valeur constitutionnelle. À l’inverse, quand il n’a pas fait l’objet d’une consécration constitutionnelle, alors le PGD a une valeur infralégislative.
Cependant, les PGD sont dégagés par le Conseil d’État pour censurer des actes administratifs dans le cadre de recours (au maximum, contre un décret en Conseil des ministres), donc les PGD servent au juge administratif dans le cadre de son contrôle de légalité des actes administratifs.
Le Conseil constitutionnel utilise lui les PVC pour contrôler la constitutionnalité des lois.
- Selon René Chapus, les PGD ont la même valeur que la bouche qui les dégage, c’est-à-dire celle du Conseil d’État.
- Tous les PGD sont dégagés exclusivement par le Conseil d’État, en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif.
- Le Conseil d’État peut censurer un acte administratif, mais il ne peut pas contrôler la constitutionnalité des lois.
Conséquence : les principes qu’il dégage doivent être situés entre la loi dont il est le serviteur, et les actes administratifs dont il est le censeur.
Les PGD ont donc une valeur infralégislative (< aux lois) et suprédécrétale (> aux décrets).
Cette 3ème thèse est la plus convaincante, mais est aussi celle qui ressort des conclusions des rapporteurs publics du Conseil d’État :
Conseil d’État, 1996, Koné :
M. Koné a bénéficié de la création d’un PFRLR selon lequel il est interdit d’extrader un étranger pour un motif politique.
Le Conseil d’État a voulu protéger M. Koné en créant un PGD, mais il s’est aperçu que ça ne servirait à rien, parce que l’extradition résulte d’un accord bilatéral, qui est un traité international.
→ Les PDG ne peuvent pas avoir une valeur dépassant celle de celui qui les consacre.
Le Conseil d’État a donc eu l’idée très audacieuse et critiquable de dégager un PFRLR, qui tirent leur valeur constitutionnelle du texte qui fait référence à l’attachement de la République à ces principes : le préambule de la Constitution de 1946.
B – La place des PGD parmi les sources du droit administratif
Il y a eu un “âge d’or des PGD”, période durant laquelle le Conseil d’État en a dégagé beaucoup : l’après-guerre et les années 1970.
À partir des années 2000, le Conseil d’État a très rarement utilisé la technique des PGD.
Il l’a quand même fait dans un arrêt retentissant :
Conseil d’État, 2006, Société KPMG :
Affirme que le principe de sécurité juridique est un principe général du droit.
Vertu protectrice du PGD : objectif de protéger le public contre les effets néfastes des changements de règlementation.
KPMG reste aujourd’hui le dernier grand PGD.
On peut expliquer cette place moins importante des PGD aujourd’hui par :
- Le fait que le champ a déjà été bien balisé : le Conseil d’État a déjà dégagé une cinquantaine de PGD.
- Le fait qu’il y a beaucoup plus de dispositions ayant pour objet de protéger les personnes aujourd’hui qu’auparavant.
La multiplication des droits et des dispositifs de protection des personnes a pour conséquence que le Conseil d’État peut piocher dans cette boîte à outils pour assurer la protection des usagers et agents du service public.
Idée : si on peut censurer un acte sur le fondement d’un article de la CEDH, on peut juste appliquer la disposition textuelle et ça ne sert à rien de dégager un principe jurisprudentiel.
Pour autant, les PGD conservent une valeur subsidiaire : ils permettent de combler une éventuelle lacune textuelle.